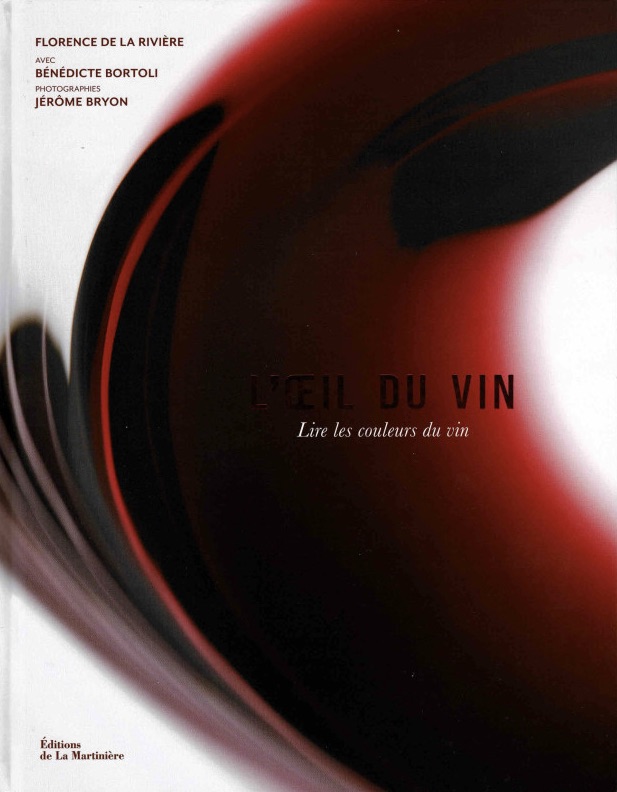À la tête du bureau d’étude Orangedesigner, cette plasticienne coloriste signe « L’Œil du Vin ». Une invitation à apprécier le contenant de nos verres autrement, avec plus de simplicité, grâce à la vue, le plus universel de nos sens. Présentation, à l’occasion de sa participation à l’édition 2025 de Livres en Vignes.
En quoi consiste votre métier ?
Je m’occupe de modeler des espaces, avec la matière, la couleur et la lumière comme matériaux. Lorsqu’il s’agit de lieux publics, le bien-être de chacun guide ma démarche. Dans le cadre de commandes privées, s’ajoutent davantage à cela le confort visuel des intéressés et leurs attentes en matière d’ambiance.
Comment êtes-vous arrivée dans l’univers du vin au point d’enseigner ses couleurs à la Faculté d’Œnologie de Bordeaux ?
La couleur est pluridisciplinaire par nature. Le vin n’y échappe pas. Reste que, dans ce domaine, le vocabulaire chromatique manque. Déconsidérée, la dégustation visuelle a perdu ses mots. Fort de ce constat et compte tenu de mon expertise, les équipes de la Faculté d’Œnologie de Bordeaux m’ont sollicitée, avec l’ambition de redonner à la dégustation visuelle le vocable nécessaire, d’être à nouveau capable de poser des mots intelligibles sur les sensations perçues lors de ce type de partages. Dans cette quête, une formation s’imposait : ayant vécu à Bordeaux près de 30 ans, j’avais une approche très décodée du vin. J’ai donc multiplié les rencontres auprès de vignerons, de sommeliers et autres experts, comme Jacques Puisais, le créateur de l’Institut du Goût ou encore Pascal Ribéreau-Gayon, professeur émérite de l’Institut d’Œnologie de Bordeaux. J’ai fait beaucoup de recherches aussi, avec « Le Goût du Vin » en tête. Un ouvrage de référence, initié par Émile Peyneaud et repris par Jacques Blouin, qui m’aidée dans mes premières réflexions sur ce livre…
Vous parliez d’une déconsidération de la dégustation visuelle…
Au XIXème siècle, ses mots étaient encore posés et leurs significations connues. Et puis, petit à petit, des chiffres les ont remplacés. La couleur n’était plus discutée mais analysée. Les laboratoires l’ont fait sienne. Mais, à qui parlent ces indices ? La dégustation nécessite des mots, qui plus est accessibles : c’est un moment d’échanges, de partages… Comme disait Bernard Pivot, « le vin est vecteur de culture ». À nous de cultiver cela, de le transmettre et donc de disposer du vocabulaire utile.
Pour mieux poser les mots en question, encore faut-il savoir de quoi on parle. C’est là tout le sujet de la première partie de votre ouvrage. Qu’est-ce qui détermine la couleur d’un vin ?
Sa teinte et son intensité colorante. La seconde se définit à la fois par la quantité de matière – la tonalité est-elle légère ou foncée ? – et sa qualité – est-elle vive ou éteinte ? –. La première, elle, c’est le cœur de notre sujet. Dans mon livre, j’ai identifié cinq grandes familles de teintes pour les rouges : encre, pourpre, rubis, grenat et tuilé. Je tenais absolument à cette simplicité. À mes yeux, il fallait que les lecteurs découvrent ces mots et comprennent précisément, par la photographie, de quoi il s’agit, de manière à les enregistrer dans l’instant, pour, demain, les utiliser à bon escient et les partager à leur tour.
L’illustration de votre livre a, du coup, nécessité la mise en place de tout un protocole photographique…
Des valises entières, que Jérôme Bryon, le photographe, devait transporter partout. Il y avait là toute une chambre portative permettant d’isoler le verre de son environnement et de le soumettre à une lumière neutre, réplicable à l’identique, pour autoriser ensuite les comparaisons d’un vin à l’autre. Reste que, sur les couleurs foncées et claires, cette installation se révélait insuffisante. L’œil voit des choses que la photographie ne rend pas. Nous avons donc dû nous réinventer sur ces teintes, pour en donner la lecture la plus juste possible.
Dans la vie de tous les jours maintenant, comment chacun de nous peut-il apprécier au mieux la couleur d’un vin ? Existe-t-il un cadre, des usages, à respecter ?
Oui, bien sûr. Une lumière naturelle d’abord ; une certaine quantité de vin ensuite, identique d’un verre à l’autre si vous faites des comparaisons – puisque cela influe sur votre perception de la couleur – et, enfin, une inclinaison du verre saisi par le pied, entre le pouce et l’index, de façon à ne pas masquer de votre main la couleur du vin et à pouvoir observer comme il se doit son disque et sa frange. Le premier renseigne sur son intensité colorante et la seconde sur sa teinte, dans toutes ses nuances.
Quels types de renseignements nous donne la couleur d’un vin ?
On a coutume de dire qu’elle est le « visage du vin ». On y lit son âge et son caractère. De manière plus concrète, la dégustation visuelle peut apporter des informations sur une orientation nord ou sud, un cépage, un stade d’évolution… Mais attention, il ne saurait s’agir de vérités absolues, mais plutôt des indications que la suite de l’analyse viendra confirmer ou non. « L’habit ne fait pas le moine » : un à un, les choix opérés par les vignerons, en viticulture comme en vinification, influent sur la couleur de leurs vins.
Justement, dans la seconde partie du livre, vous avez pris soin d’interroger de nombreux vignerons sur leur rapport à la couleur. Diriez-vous qu’elle guide leurs pratiques ?
D’une certaine façon, oui. Ils sollicitent leur vue au quotidien, mais ne s’en rendent souvent plus compte, comme des réflexes automatiques. À quelques exceptions près. Je pense à Thierry Germain, dans le Saumurois. Lui me confiait tout faire à l’œil, jusqu’aux choix des dates de vendange. Aucun relevé. C’est rare. « J’ai dû apprendre à me faire confiance », avait-il ajouté. D’autres, encore moins nombreux, vont plus loin encore, en recherchant une couleur de vin précise. C’est le cas de Dirk Niepoort, de la maison de portos éponymes. Clarté et transparence le guident. Elles sont, à ses yeux, des signes de fraîcheur et d’élégance. C’est dans cette quête qu’il a jeté son dévolu sur des vignes plus que centenaires, en altitude, exposées nord ; qu’il vendange tôt et qu’il extrait moins. À chacun ses méthodes, sa vision…
Et la Bourgogne dans tout ça ?
J’y ai été extrêmement bien reçue. Yves Confuron m’a parlé de structure, des rapports qu’entretiennent tanins et anthocyanes et donc de couleurs. Aubert de Villaine m’a offert un pur moment de grâce, autour de la question des mots du vin. Albéric Bichot a eu la gentillesse de nous recevoir à un moment sensible, en pleines vendanges… Des échanges passionnants et un constat : de manière très générale, le pinot noir a tendance à donner des vins rouges à la robe plus légère que ceux issus d’autres cépages. Dans leur jeunesse, les jus sont plutôt rubis, rarement pourpres, cerise à la limite. Puis, avec le temps, ce rouge s’allège. La couleur tombe. Des notes orangées et vermeille apparaissent, laissant entrevoir sur des vieux grands millésimes cette incroyable flamme.