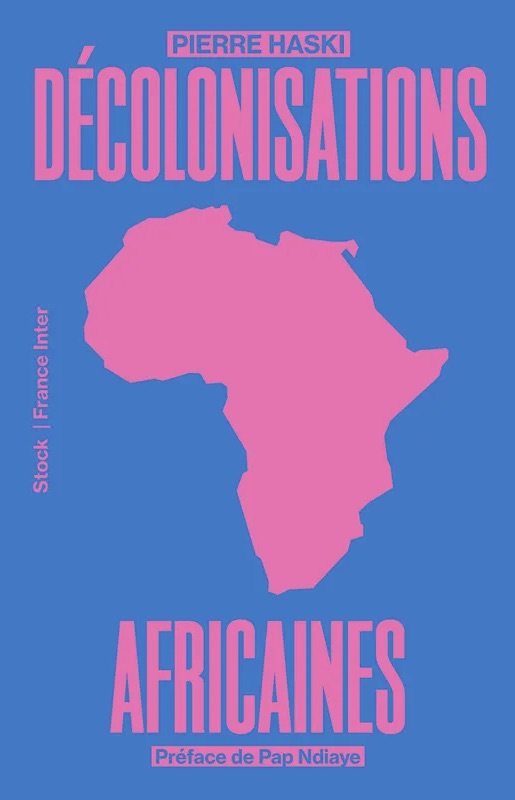L’ancien correspondant de l’A.F.P puis de Libération sur trois continents vient de publier l’adaptation de sa série de podcasts Décolonisations africaines, diffusée sur France Inter, durant les étés 2022 et 2023. Présentation, avant sa venue à l’Athenaeum le 3 mai prochain.
Pourquoi vous être emparé de ce sujet, aujourd’hui qui plus est ?
Un évènement très précis a présidé à la réalisation de ce podcast et, donc, de ce livre. En 2021, j’assistais à l’avant-première de Twist à Bamako. Ce film de Robert Guédiguian raconte le Mali du début des années 1960. Alors que le pays vient de gagner son indépendance, deux générations s’opposent : les vieux dirigeants socialistes, mus par la nécessité de développement, et toute une partie de la jeunesse, ne pensant elle qu’à danser le twist. À la fin de la projection, interrogé par un spectateur, l’acteur principal, un jeune Malien élevé à Montreuil, reconnaissait n’avoir jamais eu connaissance de ce passé. Ni ses parents ni ses enseignants à l’école ne lui en avaient parlé. Je n’en revenais pas. Comment ces enfants avaient pu passer à côté de l’histoire postcoloniale de leur pays d’origine ? Comment se faisait-il qu’ils n’aient jamais eu vent du parcours de Modibo Keïta, le père de l’indépendance du Mali et figure africaine emblématique ? C’est de ce constat qu’est partie la série. Ce passé mérite d’être retenu en ce qu’il éclaire notre présent.
Deux nations principalement colonisent l’Afrique à partir du XVIIe : la France et l’Angleterre, chacune avec leur propre organisation. Au début du XXe, qu’est-ce qui distingue le colonialisme français du colonialisme anglais ?
L’un et l’autre sont très différents. Je vais vous donner un exemple. Si les Britanniques ont créé, dès les années 1920, des universités en Afrique, comme Makéréré en Ouganda ou Ibadan au Nigeria ; les Français, eux, ont pris un tout autre parti, en accueillant sur notre sol les élèves les plus méritants. Je pense notamment à Léopold Sédar Senghor, futur président du Sénégal, un temps assis sur les bancs de Louis-le-Grand à côté d’un certain Georges Pompidou. D’un côté, une démarche très pragmatique – chacun chez soi – ; de l’autre, une approche nettement plus intégrationniste – en tout cas pour une élite – multipliant les interactions entre l’empire et la métropole. Tant est si bien que, au moment des décolonisations africaines, l’Angleterre coupe le cordon ; tandis que la France, elle, met en place ce système de gestion postcolonial appelé la Françafrique.
Malgré tout, dans un cas comme dans l’autre, les décolonisations se succèdent en Afrique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Existe-t-il des raisons communes, un contexte favorable à cette vague d’indépendances ?
Deux évènements à mes yeux favorisent l’éveil des consciences. Le premier, c’est justement la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle les troupes coloniales sont mobilisées. Pensez qu’en 1944, lors du débarquement de Provence, elles constituent à elles seules 80 à 90% des forces françaises en présence, et ce dans l’objectif de nous libérer ! De retour en Afrique, c’est la douche froide pour ces combattants. Les promesses faites, notamment par le général de Gaulle à l’issue de la conférence de Brazzaville, n’ont pas été tenues. Le désir d’indépendance en ressort grandi. Le deuxième, c’est la guerre froide. Les Soviétiques soufflent sur les braises du colonialisme, en incitant les peuples concernés à se soulever contre les puissances impérialistes. Et ça marche. Félix Houphouët-Boigny, par exemple, premier président de la Côte d’Ivoire, grand ami de la France, est apparenté communiste, en 1946, lorsqu’il est élu député à l’Assemblée nationale.
« Les leaders de la décolonisation n’ont, le plus souvent, pas fait de bons chefs d’État », écrit Pap Ndiaye en préface de votre livre. Comment l’expliquez-vous ? Quelle est la part de responsabilités des colonisateurs dans ce succès en demi-teinte ?
Toute cette génération de libérateurs et, donc, ces premiers présidents partageaient, pour la plupart, une vision très politique de leur action. Il s’agissait avant tout de bouter les colonisateurs hors de chez eux et de construire une souveraineté autour d’un drapeau, un hymne, une armée, un siège à l’O.N.U.… De sorte que très peu anticipaient ce que serait la gestion d’un État, d’un point de vue économique et social notamment. « L’intendance » les a vite rattrapés. Au Ghana, Kwame Nkrumah se retrouve ainsi interloqué lorsqu’il apprend de la bouche de ses ministres qu’après huit années d’exercice du pouvoir, il ne reste dans les caisses de l’État que 500.000 livres sterling. Sa gestion a conduit le pays à la faillite. Un signe parmi d’autres que l’idéalisme politique de la décolonisation n’a pas su trouver son pendant gestionnaire.
Et, aujourd’hui, que reste-t-il de ces libérateurs ?
Notre histoire coloniale a laissé des traces. Prenez l’exemple des rapports qu’entretient la France avec l’Afrique. Après 60 années de présence et d’actions, l’armée française vient de quitter, pour la première fois, la quasi-totalité des pays africains où elle était présente. De la même façon, il y a seulement 3 ans, Emmanuel Macron annonçait au Cameroun la création d’une commission d’historiens chargés de faire la lumière sur la façon dont nos soldats s’étaient comportés au moment de l’indépendance du pays… Le passé continue de peser sur le présent. D’où la nécessité de mieux le connaître ou, comme le dit très justement en préface Pap Ndiaye « de regarder les fantômes dans les yeux ».