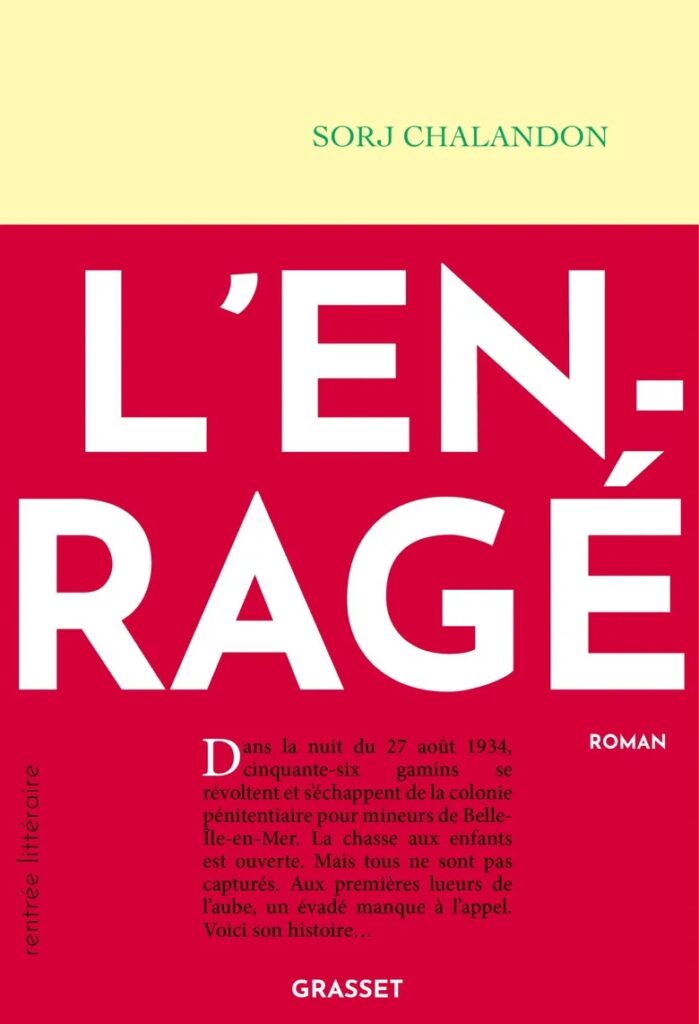À l’occasion de sa venue à l’Athenaeum le 3 février prochain, le journaliste et ancien grand reporter, prix Albert-Londres 1988, revient sur son dernier roman L’Enragé. Dans la nuit du 27 août 1934, 56 gamins se révoltent et s’échappent de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer. Les fugitifs sont immédiatement traqués. Tous sont repris. Sauf un…
Comment est né ce 11ème roman ?
Tous mes livres naissent de quelque chose qui m’est proche, qui m’est familier. Comme je l’ai déjà écrit et dit, je suis un enfant battu. Je l’ai été dès l’âge de 12 ans, avant de m’enfuir. Pendant tout ce temps, j’étais constamment menacé par mon père d’aller en maison de correction ou, comme il le disait aussi « de redressement ». Un lieu situé sur une île, en Bretagne, où – je cite – « les parents ne revoyaient pas la gueule de leur enfant »… Bien des années plus tard, en 1977, alors que je travaille pour le quotidien Libération depuis 4 ans, j’apprends que le Centre d’éducation surveillée de Belle-Île-en-Mer a fermé ses portes. Je fais très vite le rapprochement. La maison de redressement dont me parlait mon père est donc cette ancienne colonie pénitentiaire pour enfants ouverte en 1880. Mais, que faire de cette information ? Personne ne connait le lieu. Traiter de sa fermeture, dans un journal de 12 pages à l’époque, n’a aucun sens. Mener une enquête approfondie demande des moyens que je n’ai pas. N’étant de surcroît ni historien ni sociologue, je laisse filer. Sans que le malaise passe : ce lieu existait, j’aurais pu être l’un de ses détenus… Après la mort de mon père et celle de ma mère, puis l’écriture d’Enfant de salaud, j’ai le sentiment de disposer de plus de temps. La possibilité d’un roman se dessine. Une revanche sur les menaces de mon père. La dernière, je pense – et j’espère -, de l’enfant battu que j’étais.
Durant toutes ces années, le projet de ce livre vous a donc hanté ?
Ce qui m’a hanté, c’est que j’aurais pu être placé là, par mes parents. Ce qui m’a hanté, c’est aussi la volonté de rendre hommage à ces gamins. Exactement comme je l’avais fait à travers Le jour d’avant, pour les 42 ouvriers morts lors de la catastrophe minière de Liévin en 1974. Mais, pour cela, il me faut le début d’une histoire, un moyen de me rapprocher le plus possible du sujet de cette colonie…
Et ce moyen, quel est-il ?
Toutes les archives de Belle-Île-en-Mer ont brûlé en 1959. Reste quelques livres signés d’historiens locaux et, surtout, 10 ans d’articles et d’enquêtes réalisés par les journalistes de l’époque. À leur lecture, je tombe sur la tentative d’évasion du 27 août 1934. Parce que 56 gamins s’échappent cette nuit-là, parce que 55 sont repris, parce qu’il en manque un seul, dont on ne connait rien, ni l’état civil, ni même le nom, je m’octroie la liberté d’être ce 56ème à travers Jules Bonneau. Et voilà comment, d’une certaine façon, je peux dire à mon père : « tu voulais m’envoyer là, j’y vais ».
Toute la documentation dont vous parliez témoigne d’une véritable sidération de la France d’alors lorsqu’elle apprend l’existence d’un tel bagne. Pourtant, la population de Belle-Île-en-Mer participe volontiers à la chasse aux enfants évadés…
Bien sûr. Il n’y a aucun antagonisme là-dedans. Avant l’évasion, tous les 2 ou 3 mois, les habitants de l’île voient arriver un contingent de gamins, âgés de 12 à 21 ans, enchainés les uns aux autres, crâne rasé, sabots aux pieds. Direction le centre pénitentiaire. Qu’ont fait ces enfants ? Ils n’en savent rien. « S’ils sont là, c’est bien qu’on leur reproche quelque chose », doivent-ils se dire. À aucun moment ne leur vient l’idée que ce sont peut-être aussi, pour certains, des orphelins, des vagabonds, des cancres turbulents… De fortes têtes certes, mais tout juste des chapardeurs de pains ou de vêtements. Ils ne se posent pas de questions, ne cherchent pas plus loin. D’autant que ces gamins nourrissent l’île, par leur travail forcé et non payé, auprès des agriculteurs, des pêcheurs, des lavandières ou encore des commerçants locaux. C’est ensuite que vient la sidération. Avec la tentative d’évasion. La presse nationale débarque. Elle s’empare du sujet. Si le pénitencier est fermé aux journalistes ; autour, les langues d’anciens colons, restés sur l’île faute de mieux, se délient. Dans Paris-Soiret Détective, les premiers articles sortent, sur les profils des enfants, leurs conditions de détention, les morts de maladie, de faim, de noyade… C’est la découverte absolue. Un séisme.
De manière schématique, ce roman se divise en deux : l’avant évasion et l’après. Une deuxième moitié plus romancée, moins sombre…
La première partie indique qui est Jules Bonneau et d’où il se sauve. C’est la tentative de destruction d’un enfant par la justice, pour en faire un adulte docile qui ira à l’usine exactement comme il ira au cimetière. La seconde, elle, pose la question de la suite. Et maintenant ? Comment faire pour apprendre à desserrer les poings, rester droit, voire, si c’est possible, retrouver un équilibre ? C’est sans doute moins dur que la détention, mais pas moins compliqué. Comme ces évadés, j’ai passé le mur à 16 ans et demi. J’étais sans domicile fixe. Je vivais dans la rue, sur les trottoirs, dans les squares… Et là, que fait-on ? Suivant le chemin qu’on prend, les personnes sur qui on tombe, celles à qui on se confie, tout peut basculer. Cette deuxième partie de mon roman est aussi fondamentale que la première.
Tout au long de ce récit, le personnage de Jules Bonneau évolue : il n’est plus uniquement La Teigne, il devient davantage Jules. Une dualité s’installe…
Cette dualité a toujours existé, avant et après l’évasion. Jules comme moi, nous étions La Teigne, parce qu’il fallait se battre. Enfant, j’étais bègue, de manière très prononcée. Tout le monde se moquait de moi. Je n’avais pas la parole pour répondre. Juste les poings. Je frappais. C’était le seul moyen de me faire respecter. J’ai offert ça à Jules Bonneau. Mais pas seulement. Cette violence-là, lui comme moi, nous nous en servions aussi pour défendre les plus faibles lorsqu’ils se faisaient attaquer, en l’occurrence, dans le roman, Camille Loiseau. Dans ces moments, alors qu’il est encore au centre, en La Teigne apparait Jules Bonneau…
Votre roman revêt d’autres réalités surprenantes comme la présence avérée sur l’île de Jacques Prévert…
Jacques Prévert est effectivement là, à Belle-Île-en-Mer, après la tentative d’évasion. Il en tirera un poème célèbre, La chasse à l’enfant, que la France entière récitera, y compris mes filles. Un élément à charge pour la fermeture des bagnes. Je m’en sers, évidemment : à force de coups reçus, alors qu’il n’a aucune éducation, Jules Bonneau ne saurait se pâmer devant le poète. Ça n’aurait aucun sens. Il reste lui-même. Il se fout ouvertement de cet homme et de ses écrits…
Le roman se déroule à l’entre-deux-guerres. En pleine période de montée du fascisme. C’est aussi cela qui vous a interpellé dans cette histoire, comme un écho à notre époque ?
Si les faits avaient eu lieu sous de Gaulle ou Pompidou, je n’aurais pas écrit ce livre, je pense. Durant cette nuit du 27 août 1934, entre ceux qui chassent les enfants et ceux qui tentent de les aider, se met en place quelque chose qui tient de la collaboration d’une part et de la résistance d’autre part. Avant même la guerre, sur une partie du territoire nationale, une île coupée du monde, tout est déjà là : les socialistes et les communistes d’un côté, les radicaux et les Croix-de-Feu de l’autre. Comme une répétition générale de ce qui s’annonce.
Au final, vous considérez ce roman comme plus proche de vous que d’autres qui étaient pourtant autobiographiques. Comment expliquez-vous cela ?
Dans la folie de mon père, j’ai longtemps cru que cette maison de redressement où il menaçait de me placer n’existait pas. Lorsque j’ai réalisé que je m’étais trompé, que j’aurais pu terminer là, j’ai été pris d’un immense effroi. Aujourd’hui, j’ai 71 ans. Il m’a fallu une vie entière pour digérer le fait que mon père voulait ma mort et son décès pour rassembler toutes mes terreurs et ma rage d’enfant dans ce roman. J’étais certain qu’il ne me rattraperait pas.